Le jumeau numérique dans le secteur ferroviaire est une réplique numérique dynamique d’un actif, d’un système ou d’un ensemble d’infrastructures physiques. Il permet de visualiser, simuler et anticiper l’état, le comportement et l’évolution du réseau ferroviaire, à partir de données collectées en temps réel ou mises à jour régulièrement. Son utilité est multiple : il facilite la supervision des actifs, l’analyse des dégradations, la planification des opérations de maintenance ou encore la prévision d’incidents. Grâce à lui, les gestionnaires peuvent simuler des scénarios d’exploitation ou de travaux, évaluer les impacts avant toute intervention, et ainsi réduire les risques et les coûts. En s’appuyant sur des objets descriptifs (tronçons, lignes, zones techniques…) et des données précises issues du terrain, le jumeau numérique devient une plateforme unifiée pour la prise de décision, le dialogue entre métiers et la capitalisation des connaissances. Il représente une étape clé vers une infrastructure plus intelligente, connectée et résiliente.

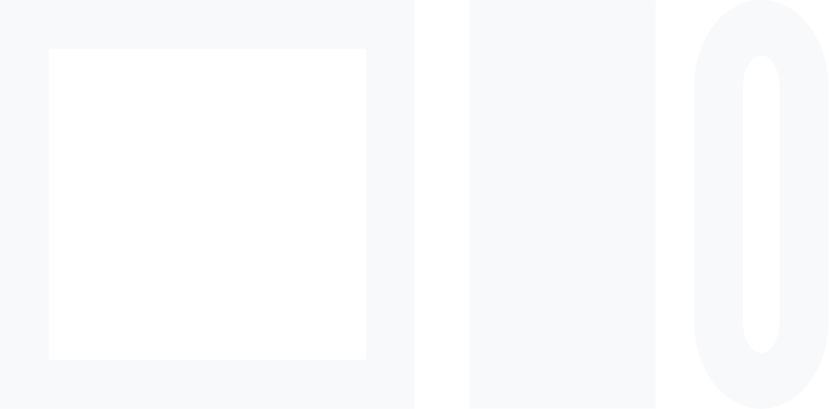
MODULOPI répond aux questions que vous vous posez !
-
Quelle utilité d'un jumeau numérique dans le ferroviaire ?
-
Que signifie une stratégie data driven au sens de l'infrastructure ferroviaire ?
Une stratégie data driven appliquée à l’infrastructure ferroviaire consiste à fonder les décisions, les opérations et les priorisations sur l’exploitation intelligente des données issues du réseau. Cela implique de collecter, structurer et analyser des données fiables provenant des actifs physiques (voies, caténaires, signaux…), des objets descriptifs (lignes, tronçons, zones de maintenance), mais aussi des systèmes de surveillance, de maintenance et d’exploitation. L’objectif est double : améliorer la performance du réseau (disponibilité, sécurité, régularité) et optimiser l’utilisation des ressources (budget, équipes, matériel). Une telle stratégie repose sur plusieurs leviers : la modélisation numérique des actifs, la centralisation des référentiels, l’interopérabilité des données, et l’usage d’outils d’aide à la décision ou d’intelligence artificielle. Dans ce contexte, la donnée devient un actif stratégique à part entière, capable de transformer la manière dont les gestionnaires d’infrastructure conçoivent la maintenance, anticipent les défaillances ou planifient les investissements. La stratégie data driven, appliquée au ferroviaire, est donc un facteur clé de résilience, de performance et de modernisation du réseau.
-
Comment définir ce qu'est une infrastructure ferroviaire ?
Une infrastructure ferroviaire regroupe l’ensemble des éléments fixes et durables qui permettent la circulation sécurisée et fluide des trains sur un réseau. Cela comprend les voies ferrées, appareils de voie, plateformes, ouvrages d’art (ponts, tunnels), caténaires, installations de signalisation, ainsi que les gares, centres de maintenance et systèmes de contrôle. Mais au-delà de la seule dimension physique, une infrastructure ferroviaire s’inscrit aussi dans une organisation spatiale et fonctionnelle : elle est structurée par des objets descriptifs (lignes, tronçons, itinéraires, zones de régulation) qui facilitent son exploitation, sa gestion et sa modélisation numérique. Définir ce qu’est une infrastructure ferroviaire, c’est donc prendre en compte à la fois ses composants matériels, son rôle dans la chaîne de mobilité, et sa représentation digitale, devenue incontournable pour optimiser la maintenance, coordonner les travaux ou simuler les évolutions du réseau.
-
Qu'est ce qu'un actif d'infrastructure ferroviaire ?
Un actif d’infrastructure ferroviaire désigne tout élément physique ou fonctionnel (identification, localisation et caractérisation en tant que données attributaires) qui constitue ou soutient le réseau ferroviaire. Cela englobe les voies ferrées, aiguillages, passerelles, ponts, tunnels, caténaires, systèmes de signalisation, installations de sécurité, gares ou postes de contrôle. Ces actifs sont essentiels pour garantir la circulation des trains, la sécurité des opérations et la résilience du réseau. En complément, le concept d’objet descriptif fait référence à une unité logique ou géographique servant à structurer et organiser ces actifs. Il peut s’agir par exemple d’une ligne ferroviaire, d’un tronçon, d’une voie unique ou double, ou d’un secteur de maintenance. Ces objets permettent de localiser, catégoriser et interpréter les actifs dans un référentiel commun, facilitant ainsi leur gestion, leur modélisation numérique et leur intégration dans les systèmes d’aide à la décision. La combinaison des actifs physiques et des objets descriptifs constitue la base de la data ferroviaire : elle permet de produire une représentation complète, exploitable et fiable de l’état et du fonctionnement du réseau.
-
Qu'est ce que recouvre la continuité numérique au sens ferroviaire ?
La continuité numérique dans le secteur ferroviaire désigne la capacité à structurer, partager et exploiter les données de manière cohérente et fluide tout au long du cycle de vie des infrastructures : de la conception à la maintenance, en passant par la construction, l’exploitation et la rénovation. Elle repose sur des référentiels communs, des modèles de données interopérables et une traçabilité des modifications dans le temps. Cette continuité permet aux différents acteurs (ingénierie, exploitants, mainteneurs, gestionnaires d’actifs) d’accéder à une vision unifiée, à jour et contextualisée des objets descriptifs (tronçons, voies, équipements) et des actifs physiques. En assurant une circulation fiable et sans rupture de l’information, la continuité numérique devient un levier majeur d’efficacité opérationnelle, de qualité documentaire, mais aussi de réduction des coûts. Elle est un pilier central pour réussir la transformation digitale du ferroviaire et garantir une exploitation plus réactive, collaborative et résiliente du réseau.
-
Comment définir le rôle d'un MOE numérique ?
Un MOE numérique (Maître d’Œuvre numérique) est un acteur ou un dispositif chargé de piloter la production, la structuration et la qualité des données numériques associées à un projet d’infrastructure ferroviaire. À la différence d’un MOE classique focalisé sur les aspects techniques et physiques des travaux, le MOE numérique se concentre sur la cohérence, la fiabilité et l’interopérabilité des données tout au long du cycle de vie du projet. Son rôle est d’orchestrer les flux de données entre les différents intervenants (bureaux d’études, entreprises de travaux, exploitants, mainteneurs), de garantir la traçabilité des objets descriptifs (lignes, tronçons, équipements) et de s’assurer que les livrables numériques sont conformes aux exigences du client et exploitables dans les systèmes d’information métier. Le MOE numérique agit ainsi comme un garant de la continuité numérique et de la valeur patrimoniale des données, en alignant les processus de modélisation, de gestion documentaire et d’intégration dans les jumeaux numériques ou les référentiels de gestion. Il est un acteur clé de la transformation digitale du ferroviaire.
-
Quels sont les enjeux de l'interopérabilité des données d'infrastructure ?
L’interopérabilité des données d’infrastructure représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises de réseaux. Elle permet la circulation fluide et cohérente des informations entre différents systèmes, acteurs et métiers. Cela garantit une vision unifiée de l’état du réseau, facilite la maintenance prédictive, optimise la gestion du matériel roulant et renforce la capacité à prendre des décisions stratégiques fiables. Sans interopérabilité, les données restent cloisonnées, ce qui freine l’efficacité opérationnelle, alourdit les processus de coordination et compromet la qualité du service rendu.
-
Comment définir la Business Intelligence ?
La Business Intelligence (BI), ou informatique décisionnelle, regroupe l’ensemble des outils, technologies et méthodes permettant de collecter, traiter, analyser et visualiser des données pour aider à la prise de décisions stratégiques. Dans le contexte des infrastructures et des réseaux, la BI permet par exemple d’identifier des tendances, d’anticiper des anomalies, d’optimiser les coûts de maintenance et de mieux planifier les investissements. Elle transforme les données brutes en informations claires, exploitables et accessibles aux décideurs comme aux opérationnels.
-
Que sont les données attributaires d'un actif ferroviaire ?
Les données attributaires d’un actif ferroviaire sont l’ensemble des informations descriptives et techniques associées à cet actif. Un actif ferroviaire peut être une voie, un aiguillage, un signal, un quai, une caténaire, etc. Ces données attributaires ne décrivent pas la forme de l’actif (comme la géométrie 3D), mais ses caractéristiques métier, telles que :
- Le type d’équipement (ex. : rail UIC60, aiguillage type CEN56)
- Son état ou niveau d’usure,
- Sa date d’installation ou de mise en service,
- Ses références techniques ou fabricants,
- Son statut (en service, hors service, à remplacer),
- Ses liens avec d’autres actifs ou sous-systèmes.
Ces données sont essentielles pour les activités de maintenance, d’exploitation, de planification des travaux ou de gestion patrimoniale. Dans un système BIM, elles sont intégrées à la maquette numérique pour offrir une vue enrichie, exploitable tout au long du cycle de vie de l’infrastructure.
-
Comment définir le BIM mandatory appliqué au secteur ferroviaire ?
Le BIM Mandatory désigne l’obligation réglementaire ou contractuelle d’utiliser la méthodologie BIM (Building Information Modeling) pour les projets ferroviaires. Dans ce contexte, cela signifie que tous les acteurs impliqués (maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, entreprises de travaux, etc.) doivent produire, partager et exploiter des maquettes numériques enrichies de données tout au long du cycle de vie de l’infrastructure (conception, construction, exploitation, maintenance).
– Dans le secteur ferroviaire, cette approche permet notamment de :
– Mieux coordonner les interventions sur des réseaux complexes et en exploitation ;
– Anticiper les conflits d’aménagement grâce à une visualisation 3D ;
– Optimiser la maintenance en disposant d’un référentiel numérique à jour ;
– Réduire les coûts liés aux erreurs ou reprises de chantier ;
– Garantir la traçabilité des données techniques dans le temps.En résumé, le BIM devient obligatoire (mandatory) pour garantir une gestion efficace, fiable et collaborative des projets ferroviaires à forte technicité.
